-
Par Pestoune le 19 Mars 2016 à 22:42

Une grenouille ayant observé un mille-pattes en plein déplacement lui demanda, piquée de curiosité : « Regarde-moi, j’ai quatre pattes qui se partagent le travail, deux devant et deux derrière ; grâce à elles, j’avance en faisant des bonds. Mais toi, j’ai beau te regarder, je ne comprends pas comment tu fonctionnes ; de tes mille pattes, laquelle avance en premier ? »
Saisi par la question, le mille-pattes s’arrêta net, incapable d’aller plus avant.
Il lui répondit : « Ne pose plus jamais cette question, ni à moi ni à n’importe quel autre mille-pattes que tu rencontreras. Je ne sais pas quelle patte avance en premier. Dès que je commence à y réfléchir, plus aucune de mes pattes ne veut bouger. Je reste alors là incapable d’avancer. »
(…) Tchouang-tseu dit : « celui qui possède une grande chose ne doit pas chercher à la gouverner ».
Inutile de s’attacher à la forme, inutile de vouloir forcer ; il faut suivre sa nature.
Yu Dan « le bonheur selon Tchouang-tseu »
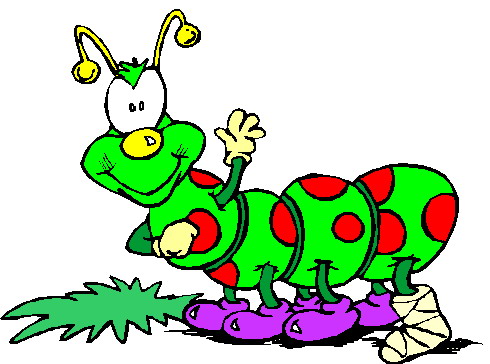
 3 commentaires
3 commentaires
-
Par Pestoune le 14 Mars 2016 à 21:49
Un vieux chef de tribu en était arrivé au moment où il devait céder sa place. Il lui fallait donc trouver un jeune homme plein de sagesse pour reprendre le flambeau. Comment le chef de tribu s’y prit-il pour tester la sagesse des prétendants à sa succession ?
De fait, il avait déjà repéré un jeune homme pour lequel il avait beaucoup d’estime. Il lui dit : « Prépare-moi deux plats. Si j’ai plaisir à manger ces plats, s’ils correspondent à mes goûts, c’est à toi que je passerai le flambeau. Pour le premier plat, recherche les meilleurs ingrédients qui puissent exister au monde et prépare-les pour moi. «
Le jeune homme prépara le premier plat et le lui servit. Le chef de tribu souleva le couvercle et regarda : le jeune homme avait cuisiné une langue. Le chef de tribu lui demanda : « Pourquoi avoir choisi de cuisiner la langue d’un animal ? « Le jeune homme lui répondit : « Parce que en ce bas monde les paroles les plus belles sont celles qui sont prononcées, il n’existe rien de plus beau que la langue. » Le chef de tribu acquiesça et mangea le plat.
Puis il dit au jeune homme : « Pour le second plat, recherche les pires ingrédients, qui puissent exister au monde et prépare-les pour moi. » Le jeune homme s’exécuta de nouveau. Le chef de tribu souleva le couvercle et regarda : le jeune homme avait de nouveau cuisiné une langue.
Le chef de tribu lui demanda : « Pourquoi avoir encore une fois choisi de cuisiner une langue ? » Le jeune homme lui répondit : « Parce que en ce bas monde les pires malheurs sont provoqués par des paroles malencontreuses, il n’existe rien de plus laid que la langue. » Le chef de tribu lui dit : « Je vois que tu as très bien compris comment fonctionne le monde. C’est à toi que je transmettrai le flambeau. »
Yu Dan « le bonheur selon Tchouang-tseu »

 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Pestoune le 11 Mars 2016 à 22:33
Trois hommes marchaient ensemble. Au coin d’une rue, ils assistèrent à la même petite scène, celle d’une petite araignée en train de grimper à l’angle du mur. Devant elle restait encore une goutte de pluie. La rencontrant, la petite araignée tomba. Elle reprit aussitôt son ascension, toujours à l’angle du mur, mais, arrivée à ce même endroit, elle retomba. Elle reprit cependant son manège, sans fin.
Cette petite scène rappela leur propre vie aux trois hommes.
Le premier pensa : « Cette araignée, c’est moi. Comme elle, depuis que je suis né, je ne cesse de grimper puis retomber, grimper puis retomber. Je passe ma vie à m’affairer sans but, plongé dans une perpétuelle et stérile agitation. »
Le deuxième pensa : « Quand je regarde cette araignée, je réalise à quel point ma vie est remplie de manquements. Nous ne faisons que regarder droit devant nous, persuadés qu’il n’y a qu’un seul chemin possible. Pourtant cette goutte de pluie n’est pas bien grande. Il suffirait que l’araignée la contourne, elle pourrait alors poursuivre sa progression vers le haut, bien au sec. Je dois absolument réorienter ma vie de façon plus intelligente. Il faut parfois savoir avancer en faisant des détours. »
Le troisième fut ébranlé par ce qu’il avait observé : « Si une aussi petite araignée peut faire preuve d’une telle persévérance, combien d’énergie un homme est-il capable de mobiliser dans sa vie ? Combien de miracles peuvent-ils encore se produire pour lui ? Tout est là, potentiellement présent dans son existence. »
Yu Dan « le bonheur selon Tchouang-tseu »

 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Pestoune le 7 Mars 2016 à 20:25
Un homme vivait avec un petit singe et un petit âne. Le petit singe était très vif et ne cessait de sautiller sur le toit de la maison. Fier de lui, son propriétaire vantait son intelligence à qui voulait l’entendre.
Le petit âne se le voyait toujours cité en exemple ; il aurait bien voulu lui aussi pouvoir sautiller sur le toit de la maison. Un jour, grimpant sur la réserve de bois adossée au mur, il réussit enfin à attendre sur son passage. Son propriétaire le ramena au sol puis lui donna une rossée mémorable.
Le petit âne ne comprit pas : « J’ai enfin réussi à faire ce que le petit singe fait toujours. Lui est cité en exemple et moi je suis rossé. Pourquoi ? »
Extrait du Tchouang-tseu
Nombreux sont ceux qui font la même expérience. Trop souvent nous cherchons à coller aux attentes d’autrui, renforçant ainsi avec zèle des critères communément admis par la société.
Ce qui est à la mode, populaire, impose des tendances qui trop souvent induisent notre cœur en erreur pour qu’il se conforme aux critères admis de tous.
(…) Plus que jamais notre regard doit sonder notre coeur, plus que jamais nous devons procéder à l’introspection, plus que jamais nous devons renoncer aux critères et aux jugements extérieurs pour déterminer nos véritables forces.
Yu Dan « le bonheur selon Tchouang-tseu
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Pestoune le 6 Mars 2016 à 22:13
« Un charpentier du nom de Shi se rendait dans le pays de Qi quand son chemin croisa un chêne. L’arbre était vénéré par les gens du coin, qui le considéraient comme une émanation du génie du sol.
L’ombrage du chêne pouvait permettre à plusieurs milliers de bœufs de prendre le frais en même temps, il mesurait cent pieds de circonférence et était aussi haut qu’une montagne. Pour atteindre ses premières branches, il faillait grimper plusieurs toises.
Cet arbre attirait les foules, et pourtant le charpentier Shi passa sans même lever la tête. Son apprenti lui demanda : « Une aussi belle pièce de bois, et vous ne lui accordez pas l’ombre d’un regard ? »
Le charpentier Shi répondit : « Ce genre d’arbres est inutile, son bois ne vaut pas grand-chose. Si l’on en fait des bateaux, ils ne tiendront pas longtemps sur l’eau ; si l’on en fait des cercueils, ils pourriront très vite ; si l’on en fait des ustensiles, ils se casseront en moins de deux ; si l’on en fait des portes, elles suinteront ; si l’on en fait des piliers, ils seront rapidement vermoulus. Cet arbre n’est donc vraiment bon à rien. »
La nuit venue, le charpentier Shi rêva que le chêne s’adressait à lui en ces termes : « Si j’avais été bon à quelque chose, comment aurais-je pu atteindre pareille taille ? Tu dis que je suis un arbre inutile. Mais si j’étais utile, ne m’aurait-on pas déjà abattu depuis longtemps ? Pourrais-je avoir atteint une telle taille et être encore ici aujourd’hui ? »
L’arbre inutile poursuivit : « Regarde les arbres fruitiers et toutes les cucurbitacées : en voilà qui sont considérés comme utiles. Chaque année ils prodiguent leurs bienfaits, et tous les couvrent d’éloges. Or, les grosses branches sont brisées tandis que les plus menues ploient sous la charge. Tous ces fruits qu’ils s’évertuent à produire année après année, à peine ont-ils mûri que les hommes viennent les en déposséder. C’est bien parce qu’ils sont utiles qu’ils se nuisent à eux-mêmes et périssent prématurément ; c’est bien parce que je suis inutile que j’ai pu me préserver aussi longtemps. Voilà ma grande utilité. »
Adaptation d’un extrait du Chapitre IV « le monde des hommes »
Un arbre ne saurait avoir pour vocation de devenir poutre ; il devrait pouvoir s’épanouir jusqu’à atteindre le Ciel et ainsi devenir objet de vénération pour tous. Cette histoire de Tchouang-tseu nous parle aussi, à nous qui vivons dans une société donnant la primauté au succès et à l’immédiateté des avantages.
Nous portons souvent un jugement définitif et borné sur les choses à l’aune de leur utilité ou de leur inutilité immédiate. Or, c’est quand on accepte d’élargir son regard qu’on comprend ce que signifie être promis à de belles choses, être véritablement utile.
Yu Dan « le bonheur selon Tchouang-tseu »
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
















