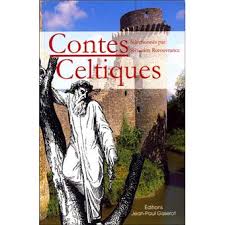-
Par Pestoune le 26 Mai 2021 à 20:55

Henry Brown ne savait pas très bien quel âge il avait. Henry était un esclave. Et les esclaves n’avaient pas le droit de connaître la date de leur anniversaire.
Henry et ses frères et sœurs travaillaient dans la grande demeure où habitait le maître. Le maître d’Henry était bon avec lui et sa famille. Mais la mère d’Henry savait que cela pouvait changer.
« Vois-tu ces feuilles qui sont emportées par le vent ? Elles sont arrachées des branches comme les enfants d’esclaves sont arrachés à leurs familles. »
Un matin, le maître appela Henry et sa mère. Ils gravirent le grand escalier. Le maître était allongé dans son lit et seule sa tête dépassait de la couverture. Il était très malade. Il leur fit signe de s’approcher. Certains esclaves étaient affranchis par leurs maîtres. Le cœur d’Henry se mit à battre. Peut-être que son maître allait le libérer.
Mais le maître déclara : « Tu es un bon travailleur, Henry. Je te donne à mon fils. Tu dois lui obéir et ne jamais dire de mensonge. »
Henry hocha la tête, mais il ne le remercia pas. Cela aurait été un mensonge.
Plus tard, ce jour-là, Henry vit un oiseau s’élever au-dessus des arbres. Un oiseau libre, c’est un oiseau heureux, se dit-il.
Henry fit ses adieux à sa famille. Il regarda de l’autre côté du champ. Les feuilles tourbillonnaient dans le vent.
Henry travaillait dans la fabrique de son nouveau maître. Il était doué.
« Ne déchire pas cette feuille de tabac ! » cria le chef au petit nouveau. Il lui donna un petit coup du bout de sa canne. Si l’on faisait une bêtise, le chef vous battait.
Henry se sentait seul. Un jour, il fit la connaissance de Nancy, qui faisait les courses pour sa maîtresse. Ils bavardèrent en continuant leur chemin et décidèrent de se revoir. Henry avait envie de chanter. Mais les esclaves n’osaient pas chanter dans les rues. Il se contenta de fredonner en rentrant chez lui. Des mois plus tard, Henry demanda à Nancy de devenir sa femme. Lorsque leurs deux maîtres eurent accepté, Henry et Nancy se marièrent.
Très vite, ils eurent un bébé. Puis un autre, et encore un autre. Henry savait qu’ils avaient de la chance. Ils avaient des maîtres différents, mais ils habitaient ensemble. Mais Nancy était inquiète. Son maître avait perdu beaucoup d’argent. « J’ai peur qu’il vende nos enfants », dit-elle.
Henry resta assis sans répondre. Henry travailla dur pendant la matinée. Il essayait de ne pas penser à ce que Nancy avait dit. Son ami James entra dans la fabrique. Il chuchota à Henry : « Ta femme et tes enfants viennent d’être vendus au marché aux esclaves.
— Non ! » s’écria Henry.
Il n’arrivait plus à bouger.
Il n’arrivait plus à penser.
Il n’arrivait plus à travailler.
« Roule ce tabac ! » dit le chef en le piquant du bout de sa canne.
Henry roula les feuilles. Son cœur se déchirait dans sa poitrine.
Au déjeuner, Henry se précipita en ville. Un groupe d’esclaves étaient attachés ensemble. Leur maître criait. Henry chercha sa famille.
« Père ! Père ! »
Henry vit ses enfants disparaître au bout de la rue. Où était Nancy ?
Il croisa son regard au même instant. Quand il essuya ses larmes, Nancy avait elle aussi disparu.
Henry ne chantait plus. Il n’y arrivait plus à fredonner. Il allait travailler le soir, il dînait et se couchait. Henry essayait de se rappeler les jours heureux. Mais tout ce qu’il voyait, c’étaient les chariots qui avaient emporté ceux qu’il aimait.
Henry savait qu’il ne reverrait jamais sa famille.
Des semaines passèrent. Un matin, Henry entendit chanter. Un petit oiseau s’éleva d’un arbre dans le ciel bleu. Et Henry pensa à la liberté.
Mais comment ? En soulevant une caisse, il trouva la réponse.
Il demanda à James et au Dr Smith de l’aider. Le Dr Smith était un blanc qui pensait que l’esclavage était une mauvaise chose. Ils se retrouvèrent de bonne heure le lendemain dans un hangar vide. Henry arriva avec une caisse.
« Je vais m’expédier moi-même dans un endroit où il n’y a pas d’esclaves ! » dit-il.
James regarda la caisse, puis Henry.« Et si tu tousses et que quelqu’un t’entend ?
— Je mettrai ma main devant ma bouche et j’espérerai », dit Henry.
Le Dr Smith écrivit sur la caisse :
À: William H. Johnson
Arch Street
Philadelphie,
Pennsylvanie.
Henry allait être livré à des amis à Philadelphie. Puis il inscrivit en grosses lettres sur le couvercle : HAUT – MANIER AVEC PRÉCAUTION
Henry avait besoin d’une excuse pour rester chez lui, sinon le chef penserait qu’il s’était enfui. James montra le doigt blessé d’Henry. Mais Henry se dit que cela ne suffirait pas. Il ouvrit une bouteille de vitriol.
« Non ! » s’écria James.
Henry en versa sur sa main. L’acide le brûla jusqu’à l’os.
À présent, le chef serait obligé de le laisser rester chez lui !
Le Dr Smith pansa la main d’Henry. Ils décidèrent de se retrouver le lendemain matin à quatre heures. Le soleil n’était pas encore levé quand Henry se glissa dans la caisse.
« Je suis prêt ! » dit-il.
James cloua le couvercle.
Le Dr Smith et James transportèrent la caisse à la gare. L’employé du chemin de fer la retourna et cloua un papier sur le fond. Le Dr Smith supplia les hommes de faire attention. Mais ils n’écoutèrent pas. Ils jetèrent la caisse dans le wagon de marchandises.
Des heures passèrent.
Henry fut de nouveau soulevé et jeté sans ménagements. La tête en bas ! Il entendit des clapotis de vagues. Ce devait être le vapeur qui partait pour Washington D.C. Le navire avançait doucement, mais Henry était toujours la tête en bas.
Le sang lui montait à la tête. Il avait les joues en feu. Ses yeux lui faisaient mal. Il crut que sa tête allait éclater. Mais il avait peur de bouger. Au cas où quelqu’un l’entendrait.
« Je suis fatigué de rester debout », dit une voix.
« Et si on retournait cette caisse pour s’asseoir dessus ? suggéra une autre voix.
Henry retint son souffle. Était-ce de sa caisse qu’ils parlaient ? On poussa la caisse. Elle racla le plancher. Il se retrouva sur le côté droit ! Et puis sur le côté gauche ! Et soudain, il se retrouva à l’endroit !
« Qu’est-ce qu’il y a dedans, à ton avis ? demanda le premier homme.
— Des colis postaux, sûrement », dit l’autre.
Je suis un colis, songea Henry, mais pas du genre qu’ils imaginent !
La caisse fut déchargée et placée dans un wagon, cette fois à l’endroit. Henry s’endormit bercé par le bourdonnement des roues du train. Des coups frappés sur la caisse le réveillèrent.
— Henry, vous allez bien, là-dedans ?
— Tout va bien ! » répondit-il.
On décloua le couvercle. Henry s’étira et se leva. Quatre hommes lui sourirent.
« Bienvenu à Philadelphie ! »
Enfin, Henry avait un anniversaire à fêter : le 30 mars 1849, son premier jour de liberté ! Et depuis ce jour, il eut un surnom. Tout le monde l’appelait Henry « Box » Brown – Henry la Caisse !
Ellen Levine
Henry et la liberté
Paris, Toucan Jeunesse, 2007
Note de l’Auteur
Au milieu du XIXe siècle, environ quatre millions d’esclaves vivaient aux États-Unis.
Les esclaves étaient des biens, au même titre qu’une table, une vache ou un chariot. Selon les historiens, entre soixante et cent mille esclaves s’évadèrent vers la liberté. Ils empruntèrent ce que l’on appela « le Train Fantôme ».
Le « Train Fantôme », bien sûr, n’était pas un vrai train. Le terme recouvre tous les itinéraires secrets qu’empruntèrent les esclaves pour fuir le Sud et gagner le Nord. Les fugitifs se cachaient dans des chariots, s’enfuyaient à cheval, parcouraient des centaines de kilomètres dans les forêts et les marais et traversaient des rivières en crue l’été ou gelées l’hiver. Ils prenaient tous les chemins possibles pour gagner la liberté. Des « contrôleurs de train » et des « de gare » les cachaient et les aidaient durant leur voyage.
Lorsque Henry Brown s’enferma dans sa « Caisse de la Liberté », il espérait être conduit dans un monde sûr. Il emporta un petit outil pour percer des trous et respirer, un peu d’eau et quelques biscuits. Sa seule inquiétude était d’être capturé. Il arriva sans encombre à Philadelphie, après avoir parcouru cinq cent soixante kilomètres depuis Richmond, en Virginie, en vingt-sept heures. Son aventure fit les gros titres des journaux en Amérique et en Europe, et Henry « Box » Brown devint le plus célèbre des esclaves fugitifs du « Train Fantôme » : l’homme qui s’était expédié vers la liberté.Source :
Un site fabuleux où vous pourrez trouver de merveilleuses histoires.
 4 commentaires
4 commentaires
-
Par Pestoune le 5 Mai 2021 à 20:57

Voilà bien longtemps, vivait dans une petite maison en bois, au cœur d’une immense forêt de la Russie, une veuve nommée Varenka. La maisonnette s’élevait au milieu d’une clairière tout entourée d’arbres. Il y venait peu de monde. Varenka disposait de tout ce dont elle avait besoin : une table et des chaises, une huche pour conserver le pain et le fromage et des étagères pour ranger la vaisselle. Il y avait, dans un coin, une icône, toujours ornée de fleurs sauvages. Le soir, comme tous les Russes de cette époque, Varenka se couchait sur le poêle encore chaud.
Varenka vivait heureuse dans sa maison jusqu’au jour où des gens passèrent, qui lui dirent : « Nous sommes pressés. Là-bas, à l’ouest, des soldats se battent et il y a déjà beaucoup de morts. Une terrible guerre a éclaté et chaque jour les armées se rapprochent. Nous nous sauvons avant qu’il nous arrive malheur. Prépare ton baluchon, bonne Varenka, et viens vite avec nous. »
Varenka eut très peur, mais elle dit : « Si je viens avec vous, qui réconfortera les voyageurs de passage, qui recueillera les enfants perdus dans la forêt, qui abritera les animaux et qui nourrira les oiseaux durant l’hiver ? Il n’y a que moi par ici : il faut que je reste. Mais vite, allez-vous-en, mes amis. Et que Dieu soit avec vous ! »
Alors les gens s’en allèrent en hâte, laissant Varenka toute seule. Elle tendit l’oreille. « On entend le grondement des canons », pensa-t-elle. « Aujourd’hui, ils sont encore loin ; mais demain ils seront là. Que vais-je devenir ? »
Varenka verrouilla la porte et ferma les fenêtres. Tandis que le soleil se couchait sur les bois, elle se mit à prier Dieu : « S’il te plaît, construis un mur autour de ma maison et les soldats ne me verront pas. »
La paix du soir s’installa doucement. On n’entendait plus les fusils, mais seulement les oiseaux qui allaient bientôt mettre la tête sous l’aile pour dormir. Les colombes roucoulaient et le rossignol chantait. Mais Dieu ne vint pas et il n’y eut pas de mur autour de la maison.
Le lendemain, Varenka s’enfonça dans la forêt pour ramasser du petit bois. Et à nouveau, elle entendit le son des canons dans le lointain. « Oh ! Ils approchent ! Pauvre de moi ! Que va devenir mon isba ? »
Avant la tombée de la nuit, Varenka rentra chez elle sans encombre. Un vieil homme, en compagnie d’un chevreau blanc, l’y attendait. C’était Piotr, le chevrier. « Que fais-tu ici ? » lui cria Varenka du plus loin qu’elle l’aperçut. « Pourquoi n’es-tu pas chez toi, avec tes chèvres et tes poussins, tes oies et tes moutons ? »
« Ma maison est brûlée et les soldats m’ont tout pris excepté ce petit chevreau », répondit Piotr. « S’il te plaît, offre-nous l’hospitalité, car nous ne savons où aller ; bientôt il fera nuit et les loups nous mangeront. »
Alors la veuve les fit entrer. Elle les installa confortablement près du poêle et servit à Piotr une bonne assiettée de soupe chaude. Et à nouveau, elle pria Dieu : « Je t’en supplie, viens vite. Construis un mur autour de ma maison et les soldats passeront sans nous voir, ni Piotr, ni le chevreau, ni moi-même. »
Le silence de la nuit envahit la forêt. Les fleurs replièrent leurs pétales. Les petits animaux qui vivaient aux creux des arbres ou dans le sol s’installèrent pour dormir. Mais Dieu ne vint pas, et il n’y eut pas de mur autour de la maison de Varenka.
Le lendemain matin, rien n’avait changé. Varenka sortit pour récolter des champignons et des herbes. Tout à coup, elle rencontra un jeune homme qui dormait au pied d’un arbre. « Réveille-toi vite », lui dit-elle, « tu ne peux rester ici : les soldats te trouveraient. Ecoute : n’entends-tu pas les canons dans la forêt ? Ils sont tout près. »
« Oui », répondit le jeune homme, « j’arrive du pays où la guerre fait rage. Tout est détruit. La terre est en feu. Je me suis sauvé dans cette forêt profonde et maintenant, je n’ai plus que cet arbre pour demeure. Mon nom est Stjepan. »
« Pauvre garçon », dit Varenka, « viens chez moi ; je te donnerai à manger et tu y seras bien au chaud. »
Alors Stjepan suivit Varenka jusqu’à sa maison. D’une main il tenait un tableau et de l’autre une fleur blanche dans un pot ; c’était un artiste et voilà tout ce qui lui restait au monde. Après la soupe, les trois amis prièrent ensemble. Et dans son cœur, Varenka pensa : « S’il te plaît, Seigneur, viens vite et construis un gros mur bien haut tout autour de ma maison. Et les soldats ne trouveront ni Stjepan, ni Piotr, ni moi. »
Durant toute la nuit, la paix régna sur la forêt. Seuls retentirent le cri de la chouette et le glapissement du renard. Au matin, Varenka regarda par la fenêtre. Elle fut remplie de crainte en voyant qu’il n’y avait toujours pas de mur autour de sa maison. Alors Varenka fit chauffer le four très fort pour y cuire du pain et des gâteaux. Tandis qu’elle s’affairait à la cuisine, elle entendit quelqu’un qui pleurait derrière la fenêtre : c’était une petite fille qui répandait des larmes amères ; elle tenait dans ses bras une colombe.
« Qui es-tu, petite, et que fais-tu là ? » lui demanda Varenka. « Entends-tu le bruit terrible de la bataille ? Tu devrais être chez toi, avec tes parents. »
« Oh ! grand-mère », dit l’enfant, « je suis Bodula Mietkova et je suis seule avec ma colombe. Papa et Maman ont été tués et je me suis sauvée. Mais j’ai senti la bonne odeur de tes gâteaux qui cuisent et cela me donne faim. »
« Entre, Bodula. Il y a toute une petite famille, ici ; tu seras la benjamine. » Bodula entra et reçut du thé et des gâteaux, tandis que la colombe picorait les miettes, toute contente.
Tout le jour, les quatre amis entendirent le tonnerre des canons. Ils pensaient que leur dernière heure était venue. Enfin, Piotr joua de la balalaïka et tous reprirent en chœur de vieux chants russes. A mesure que le jour baissait et que la lune montait dans le ciel, la musique ramena la paix.
Ce soir-là, ils prièrent encore ensemble. « Seigneur de mon cœur », dit Varenka, « je t’en supplie, construis un grand mur si haut que les soldats ne puissent pas voir ma petite maison. Et nous aurons la vie sauve, l’enfant et sa colombe, l’artiste et sa fleur, le vieil homme et son chevreau, et moi-même. J’ai peur qu’il ne soit trop tard : car demain les soldats seront ici et tout sera perdu. »
Le calme s’installa. Mais au cœur de la nuit, un petit bruit enveloppa la maison. Varenka jeta un coup d’œil au dehors : la neige tombait. Elle atteignait déjà le rebord de la fenêtre. Il neigea toute la nuit, de plus en plus fort. Et au petit matin, la maison avec ses habitants avait complètement disparu.
Vers midi, de cruels soldats s’approchèrent dans un terrible fracas. Les amis avaient très peur. Les soldats étaient vraiment tout près de l’isba. Mais ils passèrent sans la voir tant la neige la dissimulait aux regards.
Stjepan, Piotr, Bodula et Varenka remercièrent Dieu, qui les avait sauvés.
Les soldats s’en allèrent et la paix revint dans la région. Lorsque la neige eut fondu, les amis sortirent de la maison. La colombe voltigea de branche en branche, le chevreau fît de grands bonds et Stjepan planta sa fleur devant la porte de la maisonnette.
Ce fut le printemps. La chèvre eut un petit. Les graines de la fleur blanche donnèrent de nouvelles plantes. La colombe s’envola et annonça au monde que la paix régnait à nouveau.
Et Stjepan l’artiste peignit des tableaux qui racontaient avec talent l’histoire du mur de neige dont Dieu avait protégé la maison de Varenka.
Bernadette Watts
Varenka
Paris, Editions Nord-Sud, 1981 6 commentaires
6 commentaires
-
Par Pestoune le 2 Mars 2021 à 20:46
Il y avait autrefois (il y a bien longtemps, bien longtemps de cela, peut-être du temps où saint Pol vient du pays d'Hibernie dans notre île), il y avait donc à Ouessant une belle jeune fille de seize à dix-sept ans, qui s'appelait Mona Kerbili. Elle était si jolie que tous ceux qui la voyaient en étaient frappés d'admiration et disaient à sa mère :
- Vous avez là une bien belle fille, Jeanne ! Elle est jolie comme une Morganès, et jamais on n'a vu sa pareille, dans l'île ; c'est à faire croire qu'elle a pour père un Morgan.
-Ne dites pas cela, répondait la bonne femme, car Dieu sait que son père est bien Fanch Kerbili, mon marin, tout comme je suis sa mère.
Le père de Mona était pêcheur et passait presque tout son temps en mer ; sa mère cultivait un petit coin de terre qu'elle possédait contre son habitation, ou filait du lin, quand le temps était mauvais. Mona allait avec les jeunes filles de son âge, à la grève, chercher des brinics (coquilles de patèle), des moules, des palourdes, des bigornos et autres coquillages, qui étaient la nourriture ordinaire de la famille. Il faut croire que les Morgans, qui étaient alors très nombreux dans l'île, l'avaient remarquée et furent, eux aussi, frappés de sa beauté.
Un jour qu'elle était, comme d'habitude, à la grève, avec ses compagnes, elles parlaient de leurs amoureux ; chacune vantait l'adresse du sien à prendre le poisson et à gouverner et diriger sa barque, parmi les nombreux écueils dont l'île est entourée.
- Tu as tort, Mona, dit Marc'harit ar Fur à la fille de Fanch Kerbili, de rebuter, comme tu le fais, Ervoan Kerdudal ; c'est un beau gars, il ne boit pas, ne se querelle jamais avec ses camarades, et nul mieux que lui ne sait diriger sa barque dans les passes difficiles de la Vieille-Jument et de la pointe du Stiff.
- Moi, répondit Mona avec dédain - car à force de s'entendre dire qu'elle était jolie, elle était devenue vaniteuse et fière -, je ne prendrai jamais un pêcheur pour mari. Je suis aussi jolie qu'une Morganès, et je ne me marierai qu'avec un prince, ou pour le moins le fils d'un grand seigneur, riche et puissant, ou encore avec un Morgan.
Il paraît qu'un vieux Morgan, qui se cachait par là, derrière un rocher ou sous les goémons, l'entendit, et, se jetant sur elle, il l'emporta au fond de l'eau. Ses compagnes coururent raconter l'aventure à sa mère. Jeanne Kerbili était à filer, sur le pas de sa porte ; elle jeta sa quenouille et son fuseau et courut au rivage.
Elle appela sa fille à haute voix et entra même dans l'eau, aussi loin qu'elle put aller, à l'endroit où Mona avait disparu. Mais ce fut en vain, et aucune voix ne répondit à ses larmes et à ses cris de désespoir.
Le bruit de la disparition de Mona se répandit promptement dans l'île, et nul n'en fut bien surpris. "Mona, disait-on, était la fille d'un Morgan, et c'est son père qui l'aura enlevée." Son ravisseur était le roi des Morgans de ces parages, et il avait emmené la jeune Ouessantine dans son palais, qui était une merveille dont n'approchait rien de ce qu'il y a de plus beau sur la terre, en fait d'habitations royales.
Le vieux Morgan avait un fils, le plus beau des enfants des Morgans, et il devient amoureux de Mona et demanda à son père de la lui laisser épouser. Mais le roi, qui, lui aussi, avait les mêmes intentions à l'égard de la jeune fille, répondit qu'il ne consentirait jamais à lui laisser prendre pour femme une fille des hommes de la terre. Il ne manquait pas de belles Morganezed dans son royaume, qui seraient heureuses de l'avoir pour époux, et il ne lui refuserait pas son consentement, quand il aurait fait son choix.
Voilà le jeune Morgan au désespoir. Il répondit à son père qu'il ne se marierait jamais, s'il ne lui était pas permis d'épouser celle qu'il aimait, Mona, la fille de la terre.
Le vieux Morgan, le voyant dépérir de tristesse et de chagrin, le força à se marier à une Morganès, fille d'un des grands de sa cour et qui était renommée pour sa beauté. Le jour des noces fut fixé, et l'on invita beaucoup de monde. Les fiancés se mirent en route pour l'église, suivis d'un magnifique et nombreux cortège ; car il paraît que ces hommes de la mer ont aussi leur religion et leurs églises, sous l'eau, tout comme nous autres, sur la terre, bien qu'ils ne soient pas chrétiens. Ils ont même des évêques, assure-t-on, et Goulven Penduff, un vieux marin de notre île, qui a navigué sur toutes les mers du monde, m'a affirmé en avoir vu plus d'un. La pauvre Mona reçut ordre du vieux Morgan de rester à la maison, pour préparer le repas de noces Mais on ne lui donna pas ce qu'il fallait pour cela, rien absolument que des pots et des marmites vides, qui étaient de grandes coquilles marines, et on lui dit encore que si tout n’était pas prêt et si elle ne servait pas un excellent repas, quand la noce reviendrait de l’église, elle serait mise à mort aussitôt. Jugez de son embarras et de sa douleur, la pauvre fille ! Le fiancé lui-même n’était ni moins embarrassé ni moins désolé.
Comme le cortège était en marche vers l’église, il s’écria soudain :
- J’ai oublié l’anneau de ma fiancée !
- Dites où il est, et je le ferai prendre, lui dit son père.
- Non, non, j’y vais moi-même, car nul autre que moi ne saurait le retrouver, là où je l’ai mis. J’y cours et je reviens dans un instant.
Et il partit, sans permettre à personne de l’accompagner. Il se rendit tout droit à la cuisine, où la pauvre Mona pleurait et se désespérait.
- Consolez-vous, lui dit-il, votre repas sera prêt et cuit à point ; ayez seulement confiance en moi.
Et s’approchant du foyer, il dit : « Bon feu au foyer ! » Et le feu s’alluma et flamba aussitôt.
Puis, touchant successivement de la main les marmites, les casseroles, les broches et les plats, il disait : « De la chair de saumon dans cette marmite, de la sole aux huîtres dans cette autre, du canard à la broche, par ici, des maquereaux frits, par là, et des vins et liqueurs choisis et des meilleurs, dans ces pots... » Et les marmites, les casseroles, les plats et les pots s’emplissaient par enchantement de mets et de liqueurs, dès qu’il les touchait seulement de la main. Mona n’en revenait pas de son étonnement de voir le repas prêt, en un clin-d’œil, et sans qu’elle y eût mis la main.
Le jeune Morgan rejoignit alors, en toute hâte, le cortège, et l’on se rendit à l’église. La cérémonie fut célébrée par un évêque de mer. Puis on revint au palais. Le vieux Morgan se rendit directement à la cuisine, et s’adressant à Mona :
- Nous voici de retour ; tout est-il prêt ?
- Tout est prêt, répondit Mona, tranquillement.
Etonné de cette réponse, il découvrit les marmites et les casseroles, examina les plats et les pots et dit, d’un air mécontent :
- Vous avez été aidée ; mais, je ne vous tiens pas pour quitte.
On se mit à table ; on mangea et on but abondamment, puis les chants et les danses continuèrent, toute la nuit.
Vers minuit, les nouveaux mariés se retirèrent dans leur chambre nuptiale, magnifiquement ornée, et le vieux Morgan dit à Mona de les y accompagner et d’y rester, tenant à la main un cierge allumé. Quand le cierge serait consumé jusqu’à sa main, elle devait être mise à mort.
La pauvre Mona dut obéir. Le vieux Morgan se tenait dans une chambre contiguë, et, de temps en temps, il demandait :
- Le cierge est-il consumé jusqu’à votre main ?
- Pas encore, répondait Mona.
Il répéta la question plusieurs fois. Enfin, lorsque le cierge fut presque entièrement consumé, le nouveau marié dit à sa jeune épouse :
- Prenez, pour un moment, le cierge des mains de Mona, et tenez-le, pendant qu’elle nous allumera du feu.
La jeune Morganès, qui ignorait les intentions de son beau-père, prit le cierge.
Le vieux Morgan répéta au même moment sa question :
- Le cierge est-il consumé jusqu’à votre main ?
- Répondez oui, dit le jeune Morgan.
- Oui, dit la Morganès.
Et aussitôt le vieux Morgan entra dans la chambre, se jeta sur celle qui tenait le cierge, sans la regarder, et lui abattit la tête, d’un coup de sabre ; puis il s’en alla.
Aussitôt le lever du soleil, le nouveau marié se rendit auprès de son père et lui dit :
- Je viens vous demander la permission de me marier, mon père.
- La permission de te marier ? Ne t’es-tu donc pas marié, hier ?
- Oui, mais ma femme est morte, mon père.
- Ta femme est morte !… Tu l’as donc tuée, malheureux ?
- Non, mon père, c’est vous-même qui l’avez tuée.
- Moi, j’ai tué ta femme ?…
- Oui, mon père : hier soir, n’avez-vous pas abattu d’un coup de sabre la tête de celle qui tenait un cierge allumé, près de mon lit ?
- Oui, la fille de la Terre ?…
- Non, mon père, c’était la jeune Morganès que je venais d’épouser pour vous obéir, et je suis déjà veuf. Si vous ne me croyez pas, il vous est facile de vous en assurer par vous-même, son corps est encore dans ma chambre.
Le vieux Morgan courut à la chambre nuptiale, et connut son erreur. Sa colère en fut grande.
- Qui veux-tu donc avoir pour femme ? demanda-t-il à son fils, quand il fut un peu apaisé.
- La fille de la Terre, mon père.
Il ne répondit pas et s’en alla. Cependant, quelques jours après, comprenant sans doute combien il était déraisonnable de se poser en rival de son fils auprès de la jeune fille, il lui accorda son consentement, et le mariage fut célébré avec pompe et solennité.
Le jeune Morgan était rempli d’attentions et de prévenances pour sa femme. Il la nourrissait de petits poissons délicats, qu’il prenait lui-même, lui confectionnait des ornements de perles fines et recherchait pour elle de jolis coquillages nacrés, dorés, et les plantes et les fleurs marines les plus belles et les plus rares. Malgré tout cela, Mona voulait revenir sur la terre, auprès de son père et de sa mère, dans leur petite chaumière au bord de la mer.
Son mari ne voulait pas la laisser partir, car il craignait qu’elle ne revînt pas. Elle tomba alors dans une grande tristesse, et ne faisait que pleurer, nuit et jour. Le jeune Morgan lui dit un jour :
- Souris-moi un peu, ma douce, et je te conduirai jusqu’à la maison de ton père.
Mona sourit, et le Morgan, qui était aussi magicien, dit :
- Pontrail, élève-toi.
Et aussitôt un beau pont de cristal parut, pour aller du fond de la mer jusqu’à la terre.
Quand le vieux Morgan vit cela, sentant que son fils en savait aussi long que lui, en fait de magie, il dit :
- Je veux aller aussi avec vous.
Ils s’engagèrent tous les trois sur le pont, Mona devant, son mari après elle et le vieux Morgan à quelques pas derrière eux.
Dès que les deux premiers eurent mis pied à terre, le jeune Morgan dit :
- Pontrail, abaisse-toi.
Et le pont redescendit au fond de la mer entraînant avec lui le vieux Morgan.
Le mari de Mona, ne pouvant l’accompagner jusqu’à la maison de ses parents, la laissa aller seule en lui faisant ces recommandations :
- Reviens, au coucher du soleil ; tu me retrouveras ici, t’attendant ; mais, ne te laisse embrasser, ni même prendre la main par aucun homme.
Mona promit, et courut vers la maison de son père. C’était l’heure du dîner, et toute la petite famille se trouvait réunie.
- Bonjour, père et mère ; bonjour, frères et sœurs ! dit-elle, en entrant précipitamment dans la chaumière.
Les bonnes gens la regardaient, ébahis, et personne ne la reconnaissait. Elle était si belle, si grande et si parée !… Cela lui fit de la peine, et les larmes lui vinrent aux yeux. Puis, elle se mit à faire le tour de la maison, touchant chaque objet de la main, en disant :
- Voici le galet de mer sur lequel je m’assoyais, au foyer ; voici le petit lit où je couchais ; voici l’écuelle de bois où je mangeais ma soupe ; là, derrière la porte, je vois le balai de genêt avec lequel je balayais la maison, et ici, le pichet avec lequel j’allais puiser de l’eau, à la fontaine.
En entendant tout cela, ses parents finirent par la reconnaître et l’embrassèrent, en pleurant de joie, et les voilà tous heureux de se retrouver ensemble.
Son mari avait bien recommandé à Mona de ne se laisser embrasser par aucun homme et, à partir de ce moment, elle perdit complètement le souvenir de son mariage et de son séjour chez les Morgans. Elle resta chez ses parents, et bientôt les amoureux ne lui manquèrent point. Mais, elle ne les écoutait guère et ne désirait pas se marier.
La famille avait, comme tous les habitants de l’île, un petit coin de terre, où l’on mettait des pommes de terre, quelques légumes, un, peu d’orge, et cela suffisait pour les faire vivre, avec la contribution journalière prélevée sur la mer, poissons et coquillages. Il y avait devant la maison une aire à battre le grain, avec une meule de paille d’orge. Souvent, quand Mona était dans son lit, la nuit, à travers le mugissement du vent et le bruit sourd des vagues battant les rochers du rivage, il lui avait semblé entendre des gémissements et des plaintes, à la porte de l’habitation ; mais, persuadée que c’étaient les pauvres âmes des naufragés, qui demandaient des prières aux vivants oublieux, elle récitait quelques De Profundis à leur intention, plaignait les matelots qui étaient en mer, puis elle s’endormait tranquillement.
Mais, une nuit, elle entendit distinctement ces paroles prononcées par une voix plaintive à fendre l’âme :
- O Mona, avez-vous donc oublié si vite votre époux le Morgan, qui vous aime tant et qui vous a sauvée de la mort ? Vous m’aviez pourtant promis de revenir, sans tarder ; et vous me faites attendre si longtemps, et vous me rendez si malheureux !… Ah ! Mona, Mona, ayez pitié de moi, et revenez, bien vite !…
Alors, Mona se rappela tout. Elle se leva, sortit et trouva son mari le Morgan, qui se plaignait et se lamentait de la sorte, près de sa porte. Elle se jeta dans ses bras… et depuis, on ne l’a pas revue.
(Conté par Marie Tual, dans l’ile d’Ouessant, en mars 1873.)
J’ai encore recueilli, dans l’ile d’Ouessant, en mars 1873, les traditions et renseignements suivants sur les Morganed et Morganezed ; c’est du reste la seule localité où j’en aie trouvé trace, dans la tradition populaire :
« Les Morganed et Morganezed, me dit Marie Tual, de qui je tiens le conte du Morgan et de la Fille de la terre, étaient autrefois très communs, dans notre île ; aujourd’hui, on les voit encore quelquefois, mais rarement ; on les a trop souvent trompés. On les remarquait, surtout au clair de la lune, jouant et folâtrant sur le sable fin et les goémons du rivage et peignant leurs cheveux blonds avec des peignes d’or et d’ivoire. Le jour, ils faisaient sécher au soleil, sur de beaux linceuls blancs, des trésors de toute sorte : or, perles fines, pierres précieuses et de riches tissus de soie. On jouissait de leur vue, tout le temps qu’on restait sans battre les paupières, mais, au premier battement, tout disparaissait, comme par enchantement, Morganed et trésors. Les Morganed et Morganezed sont de petits hommes et de petites femmes, aux joues roses, aux cheveux blonds et bouclés, aux grands yeux bleus et brillants ; ils sont gentils comme des anges. Malheureusement, ils n’ont pas reçu le baptême, et, pour cette raison, ils ne peuvent aller au ciel, ce qui est bien dommage, tant ils sont gentils et ont l’air bons !
« J’ai entendu dire que la Sainte-Vierge étant un jour seule à la maison et ayant besoin de s’absenter un moment, pour aller puiser de l’eau, se trouvait fort embarrassée, car elle ne voulait pas laisser seul son enfant nouveau-né, qui dormait dans son berceau.
— Comment faire ?… La fontaine est un peu loin et je ne puis laisser mon enfant seul… se disait-elle, assez haut.
« En ce moment, elle entendit une voix claire et fraîche comme une voix d’enfant, qui dit :
— Je vous le garderai bien, moi, si vous voulez me le confier.
« Elle se détourna et vit, au seuil de la porte, un petit homme souriant et si gentil, qu’elle resta quelque temps à le considérer, saisie d’étonnement et d’admiration. Elle n’hésita pas à lui confier la garde de son enfant, et alla puiser de l’eau à la fontaine.
« A son retour, pour récompenser le fidèle gardien, elle lui dit de faire une demande, et elle la lui accorderait.
— Génet ha Morgéned, c’est-à-dire : de la beauté et des petits Morgans, répondit le petit homme.
« Ce qui lui fut accordé, et c’est pourquoi les Morgans sont si jolis et étaient si nombreux, au temps jadis. Mais, il aurait mieux fait de demander le baptême, car alors, lui et les siens seraient allés au ciel avec les anges, auxquels ils ressemblent si bien. »
Ce contact de la Sainte-Vierge avec les Morgans me parut curieux.
Marie Tual me dit encore, au sujet des Morgans :
« Deux jeunes filles de notre île, cherchant un jour des coquillages, au bord de la mer, aperçurent une Morganès qui séchait ses trésors au soleil, étalés sur deux belles nappes blanches. Les deux curieuses, se baissant et se glissant tout doucement derrière les rochers, arrivèrent jusqu’à elle, sans en être aperçues. La Morganès, surprise et voyant que les jeunes filles étaient gentilles et paraissaient être douces et sages, au lieu de se jeter à l’eau, en emportant ses trésors, replia ses deux nappes sur toutes les belles choses qui étaient dessus et leur en donna à chacune une, en leur recommandant de ne regarder ce qu’il y avait dedans que lorsqu’elles seraient rendues à la maison, devant leurs parents.
« Voilà nos deux jeunes Ouessantines de courir vers leurs demeures, portant leur précieux fardeau sur l’épaule. Mais, l’une d’elles, impatiente de contempler et de toucher de ses mains les diamants et les belles parures qu’elle croyait tenir pour tout de bon, ne put résister à la tentation. Elle déposa sa nappe sur le gazon, quand elle fut à quelque distance de sa compagne, qui allait dans une autre direction, la déplia avec émotion, le cœur tout palpitant, et... n’y trouva que du crottin de cheval. Elle en pleura de chagrin et de dépit !
« L’autre alla jusqu’à la maison, tout d’une traite, et ce ne fut que sous les yeux de son père et de sa mère, dans leur pauvre chaumière, qu’elle ouvrit sa nappe. Leurs yeux furent éblouis à la vue des trésors qu’elle contenait : pierres précieuses, perles fuies et de l’or, et de riches tissus !... La famille devint riche, tout d’un coup ; elle bâtit une belle maison, acheta des terres et on prétend qu’il existe encore, parmi les descendants, qui habitent toujours l’île, des restes du trésor de la Morganès, quoiqu’il y ait bien longtemps de cela. »
Ma conteuse, Marie Tual, paraissait croire, en effet, qu’il existait réellement, dans une famille d’Ouessant, des bijoux et des tissus provenant des Morgans. « Dans cette maison, ajoutait-elle, rien ne manque ; ils sont riches ; quand ils vont a la pêche, leur bateau revient toujours chargé de poisson, et ils n’ont jamais perdu un des leurs à la mer, ce qu’on ne peut dire d’aucune autre famille de l’ile. »
Contes Celtiques aux Editions Jean-Paul Gisserot
 7 commentaires
7 commentaires
-
Par Pestoune le 23 Janvier 2021 à 21:06

Le Père Camboly, qui n'avait pas pour deux sous de malice, n'avait jamais pu de sa vie s'accorder avec sa femme.
Pour la punir, il fit en sorte de ne rien lui laisser après sa mort du peu de biens qu'il avait. N'ayant guère qu'un assez bon cheval, il s'arrangea dans son testament pour que sa femme ne puisse pas le vendre sans que le prix ne lui échappe
Voici son testament : Je donne à ma femme tout ce que je possède en propre. Mon bon cheval, il faut qu'elle le vende pour faire dire des messes pour le repos de mon âme. Le chien elle peut en faire ce que bon lui semble.
Quand Camboly fut mort, sa femme s'en alla accompagnée de son chien à la foire de Villersexel pour vendre son cheval. Tout en arrivant, elle trouva des marchands.
- Combien le cheval ? que fit l'un d'eux. Je vous en donne cent écus et je paye le café parce que vous avez dû être une belle fille dans votre temps.
- Cent écus, que répondit la femme, je veux bien mais il faut acheter mon chien avec.
- De votre chien, je n'ai que faire et n'en veut à aucun prix
- Arrêtez-voir, que fit la femme, nous voulons bien nous arranger ; vous me donnerez cent écus pour le chien et un écu pour le cheval.
- Mais pourquoi ce drôle de marché ?
- Qu'est-ce que ça peut vous faire puisque cela me va et que cela ne vous gène pas.
Et le marché fut fait.
Entrant dans sa maison, la veuve Camboly porta un écu au curé pour dire une messe à l'intention de son pauvre homme et elle empocha les cents écus prix de son chien !
Pierre MATHIOT
 4 commentaires
4 commentaires
-
Par Pestoune le 20 Décembre 2020 à 20:52
D'après une idée et sur un texte de Christian ROCHER, un conte de NOEL émouvant présenté à l'église de LA CHAPELLE LA REINE (77) pour la veillée de NOEL en 2018.
Résumé : Le soir de Noël 1918, il y a donc exactement 100 ans, deux petites filles, dont l'une s'était réfugiée seule et désespérée sous le porche de l'église de leur village, vont avoir l'immense bonheur, de plus inattendu, de retrouver leurs papas qui reviennent de la guerre ce soir là.
De l'émotion, mais aussi mise en valeur de l'entraide, de la famille, des joies de Noël, de l'optimisme dans la vie.
Réalisation vidéo, musiques (hors thèmes des chants connus) de Christian ROCHER.
https://www.youtube.com/watch?v=C8LlbTK-6Zk
 4 commentaires
4 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique